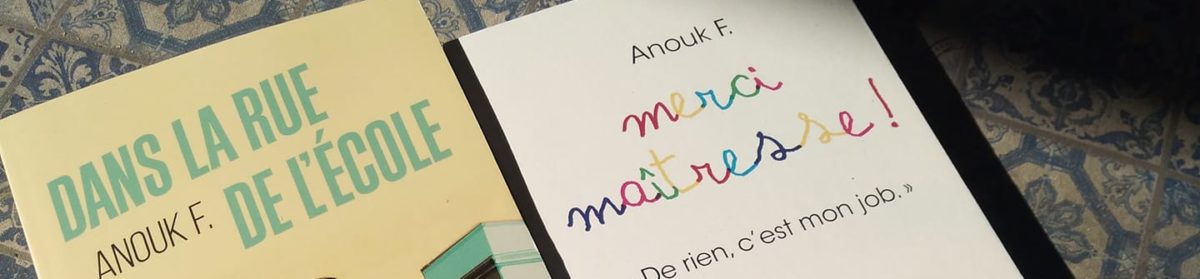Dans ma REPpublique à moi, on accueille les mots, les maux, les gestes. Ceux qu’on contrôle et ceux qui nous échappent.
Quand les mots sont sortis, quand elle s’est mise à crier, ce n’était ni le moment, ni le lieu, et encore moins la manière. Mais E. avait décidé que ce serait maintenant et que ce serait sur ce ton là. Quelque chose d’inconscient avait sans doute mûri et il fallait que ça sorte urgemment, maintenant, au milieu du vestiaire de la piscine.
J’étais en train d’essayer de faire entrer les longs cheveux de M. dans son bonnet, de dire à S. de bien ranger ses chaussettes dans ses chaussures pour être sûre de les retrouver et de secouer un peu L. qui avait décidé de ne pas se presser. Je faisais tout ça, le vestiaire bourdonnait quand E. s’est retournée et a crié : « C’est pas moi qui ai volé l’argent dans le sac de Maman, c’est pas moi, c’est Papa, il n’y a qu’à voir, les billets sont dans la poche de son manteau. ». Les abeilles se sont toutes arrêtées en même temps et on a toutes regardé E., les yeux écarquillés. Elle ne regardait que moi, ses sourcils me suppliaient de la croire et elle répétait : « C’est pas moi, c’est pas moi ».
Je ne savais évidemment pas de quoi elle parlait. Mais je connais un peu E., alors je me suis approchée, je lui ai dit que j’avais bien entendu et que je lui promettais qu’on en reparlerait, mais pas maintenant et pas ici. Elle a acquiescé et a eu l’air d’oublier, au moins un peu. Moi, je n’ai rien oublié. J’ai même ressassé, je l’ai observée et me suis un peu inquiétée.
E. a 6 ans.
E. ment. Beaucoup. Souvent.
E. vole. Dans les cartables des copains, dans les poches et ailleurs.
Alors quand elle m’a parlé du sac de Maman, du manteau de Papa, des billets et de tout ça, forcément, je me suis souvenue.
Je me suis souvenue de cette première semaine de classe. Quand j’ai confisqué le bracelet de S. parce qu’elle jouait avec. Quand j’ai voulu le rendre à S. à la fin de la matinée et qu’il avait disparu de mon bureau. Quand je l’ai retrouvé au fond du cartable de E. et qu’elle a d’abord longtemps essayé de me convaincre que quelqu’un l’avait mis là. Non, que c’est peut-être Maman qui m’a acheté le même et qui me l’a pas dit alors elle l’a mis dans mon cartable. Non, je sais, en fait, c’est celui de ma petite sœur, je le reconnais. Qu’elle a fini par craquer, pleurer, exploser, poser sa tête sur mon épaule, renifler et me promettre, yeux dans les yeux, qu’elle ne le ferait plus. Je n’ai pas eu de mal à me rappeler qu’elle avait recommencé.
Un peu plus tard, ailleurs, j’ai donc demandé à E. de venir m’expliquer. Avant qu’elle ne commence, je lui ai rappelé qu’elle devait me regarder dans les yeux, ne pas me mentir et qu’à partir de là, je voudrais bien croire tout ce qu’elle avait à me dire et à me raconter. E. a pris une grande inspiration, a fixé le bout de ses pieds et a parlé, très vite, des billets, de Maman, de Papa, du manteau et du sac. J’ai posé ma main sur son menton, j’ai relevé son visage vers moi et je lui ai demandé de recommencer, moins vite et en me regardant vraiment, cette fois. Les yeux qui se sont levés vers moi étaient mouillés, les joues étaient rouges et aucun mot n’est sorti. On a écouté ensemble ce silence et je lui ai promis que je viendrai avec elle pour parler à Maman, ce soir.
Maman a levé les yeux encore plus haut, vers le ciel carrément. Elle a soufflé, soupiré, agacée, fatiguée, dépassée. Deux jours que je cherche cet argent, deux jours que je sais que c’est elle. J’ai tout essayé, je l’ai punie, menacée, rien. J’ai même vidé ses tiroirs, soulevé son matelas. Je commençais à croire que j’étais folle, madame, folle. La voix est montée. Elle a tremblé en même temps. J’ai demandé à E. d’aller s’asseoir un peu plus loin mais de promettre d’abord à Maman de lui rendre les billets, dès qu’elles seraient rentrées. Elle a dit oui avec une toute petite voix, sans s’excuser vraiment, et elle s’est éloignée.
Alors Maman a pleuré. Je n’ai pas vraiment pu la rassurer. Avec des mots qui m’ont semblé justes mais qui ont sûrement continuer de la blesser, je lui ai dit qu’il fallait prendre tout ça au sérieux, que les choses s’accumulaient, qu’il était important, urgent de s’en préoccuper. Avec une toute petite voix, elle a dit oui, en s’excusant pour de bon, et elle s’est éloignée.