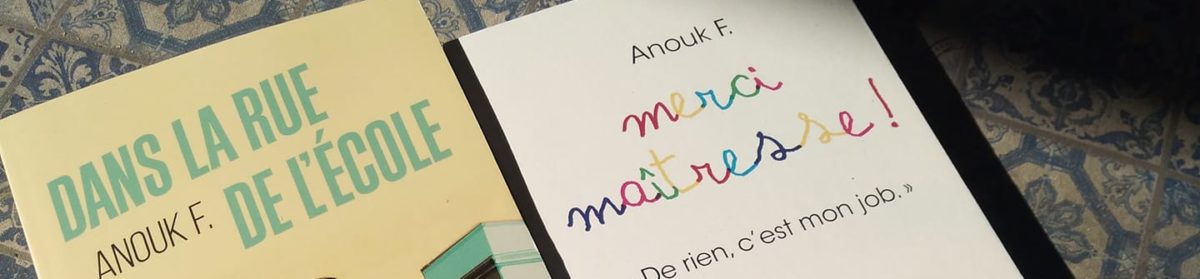Alors on en est là.
Une tête tombe, sous les mains déterminées d’un homme qui n’était encore il y a quelques mois qu’un enfant.
Un esprit s’envole, sous les huées de ceux qui se sont sentis attaqués, qui se disent blessés, qui se persuadent que leurs enfants étaient méprisés.
Un enseignant disparaît, emportant avec lui sa lumière, son envie de les emmener plus haut, de les éclairer sur le chemin de la tolérance et de la liberté.
Un père est éliminé.
Un homme est tué.
Alors on en est là.
Les bras ballants, le regard humide, on pleure, on crie, on hurle, on a peur, on s’indigne, on se révolte.
On condamne cette terreur qu’ils essaient de semer.
On déplore ce fossé qui ne cesse de se creuser. Cette société où les uns ont tellement besoin d’avoir des autres contre lesquels s’insurger.
On angoisse de ce monde dans lequel nos enfants grandissent.
Et on s’interroge. Beaucoup. Jamais trop. Encore et encore.
On se demande comment personne ne l’a protégé. Comment aucun n’a entendu ses appels à l’aide, leurs appels à la haine. Comment, tout en haut, au chaud, ils n’ont pas sorti leurs armes et leurs boucliers pour le sauver. Ne serait-ce que pour ne pas avoir ensuite à rendre hommage, mais simplement justice. Pour nous montrer à nous, tous, 800 000 que nous sommes, que nous sommes bien là pour ça, que nous avons bien plus que le droit, mais aussi le devoir de continuer à emmener nos élèves sur le chemin de la liberté. La liberté de dessiner, de dire, de penser, de réfléchir, d’écrire. D’exister.
Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait ?
On enfile nos masques DIM et on continue, coûte que coûte.
On y retourne, on parle un peu plus fort, on brandit notre détermination encore un peu plus haut.
On accompagne, on explique, on recommence, on avance.
On ne renonce pas, non jamais, ce serait trop leur accorder.
Notre bouclier, si ce n’est pas eux qui nous le fournissent, là-haut, on l’a déjà tous, au fond de nous : l’envie de leur donner une chance, à tous, sans exception.
Continuez à briser nos murs si cela vous plaît, les fondations sont solides, on s’en est occupé.