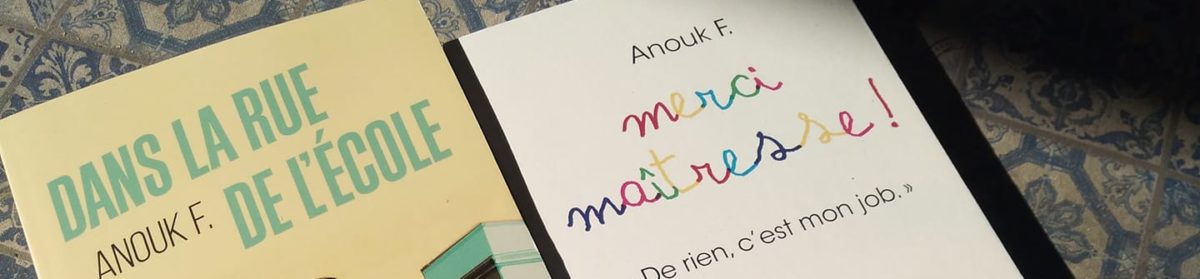Un petit oiseau. Des yeux qui s’excusent, des mains qui tremblent, et les organes internes qui s’affolent, si j’en crois les odeurs qu’il laisse derrière lui après son premier passage dans ma classe. Il sourit, opine du chef. Il y a de la déférence, du respect à l’excès dans ses gestes et sa posture. “Oui madame, d’accord madame”. Papa est vieux. Très vieux. Il remercie tout le temps. “Tout va bien se passer, I. va vite s’habituer”. Merci encore, merci, merci.
Son sac est trop lourd, trop grand pour lui. La chaise est trop haute, les camarades trop adolescents pour I. Alors les odeurs persistent et les yeux s’excusent encore. Il prend les exercices, les fait vite défiler devant lui. Trop vite. “Je sais”, il dit, quand je m’assois près de lui pour lui réexpliquer une consigne qu’il a semble t-il mal comprise. “Non, tu ne sais pas I. cet exercice n’est pas correct, on va le reprendre ensemble.”
I. regarde ses pieds, puis recommence.
I. se trompe encore.
“Maîtresse du Français, au Maroc, elle a dit c’est comme ça”.
“Tu dois bien regarder les lettres du mot, I., regarde, ce ne sont pas les mêmes ici et ici.”
Il est d’accord, bien sur. Il sourit, toujours.
Mais il trébuche, encore et encore.
Dans sa langue, les mots s’écrivent comme on les entend.
Pas de a à côté d’un u qui se transforment en o.
Pas de h après le t, juste pour faire joli.
Pas de u, prononcé avec la bouche qui imite le cul d’une poule.
Aucune lettre en trop.
Aucune lettre en moins.
C’est dur I., je sais, et ce sera long, peut-être.
Il te faudra sans doute trahir un peu Maîtresse du Français, au Maroc, et me faire confiance à moi.
Il te faudra désapprendre d’abord.
Et apprendre ensuite.
Alors, en attendant, si tes mots me font sourire, c’est aussi parce qu’ils me font un peu rêver. Calcou La Trise sera l’héroïne de l’histoire que nous allons écrire ensemble, tu veux bien? Elle aura une cape et les vaincra tous, les uns après les autres. Les A qui se liguent avec les U, les H qui viennent se coller aux T et même les accents, qui ne volent jamais dans le même sens. Alors que toi, le petit oiseau, je suis sûre que tu sais dans quel sens il faut voler.