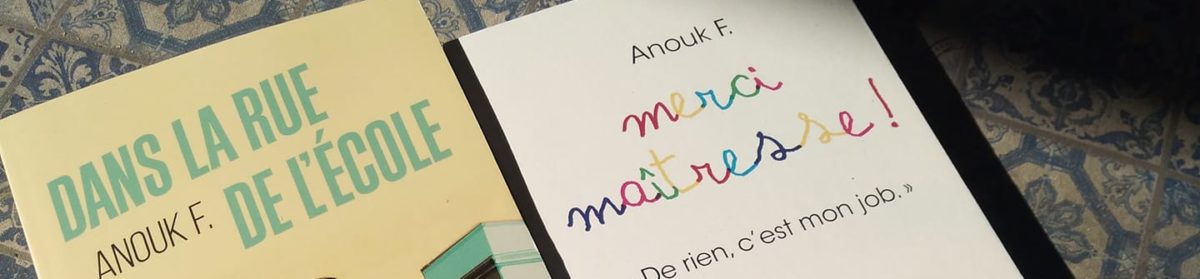J’ai prononcé le mot, plusieurs fois. Il ne l’a pas compris. Enfin si, il l’a compris, mais a sorti son double décimètre de sa trousse. Alors j’ai cherché le mot, les mots, dans sa langue. Il les a écoutés mais n’a pas réagi. “Non, je ne sais pas” a t-il ajouté.
Devant mon étonnement, il a eu l’air de s’excuser. Il faut dire que j’avais un peu haussé la voix quand il s’était adressée à W. et, sur un ton de reproche, lui avait demandé pourquoi aujourd’hui, elle ne jeûnait pas. J’ai commencé par le sermonner. Ce ne sont pas tes affaires, tu n’as pas à le lui demander. Penaud, H. s’est renfrogné. Je ruminais sans trop le montrer de ce que les uns pouvaient à ce point juger les autres, les observer. Je m’interrogeais sur les temps qui courent et ces gamins si sûr d’eux qu’ils décident de s’immiscer dans la vie des autres. Je me questionnais sur la manière dont H. regardait les filles, la façon dont il semblait les mépriser, parfois.
Puis je suis revenue vers lui.
“Sais-tu ce qui se passe dans le corps des femmes ?”
Non, il ne sait pas.
H. a 13 ans. Des parents éduqués. Il vient d’un pays européen, tout proche du nôtre. Mais personne ne lui en a jamais parlé. Personne ne lui a jamais expliqué. Personne n’a mis les mots sur ce qui sont parfois nos maux. Personne ne lui a dit ce que ses sœurs, sa mère, sa grand-mère et toutes les jeunes filles qu’il côtoie chaque jour ont vécu, vivent et vivront, parfois dans la douleur, tout au long de leur vie. Personne ne lui a dit comment venait la vie, comment nos ventres la préparaient.
Alors j’ai dessiné, j’ai raconté, j’ai détaillé. Ses yeux sont devenus ronds mais à aucun moment la gêne ne s’est installée. H. a posé des questions. H. a voulu savoir si c’était pour ça que “Maman, des fois, elle va s’allonger en plein milieu de la journée.” H. a écouté, compris, entendu. Comme n’importe quel jeune garçon, comme n’importe quel enfant, c’est avec les mots qu’il pourra entendre, et, peut-être comprendre.
Puis H. s’est levé. S’est approché de W. Et s’est excusé.