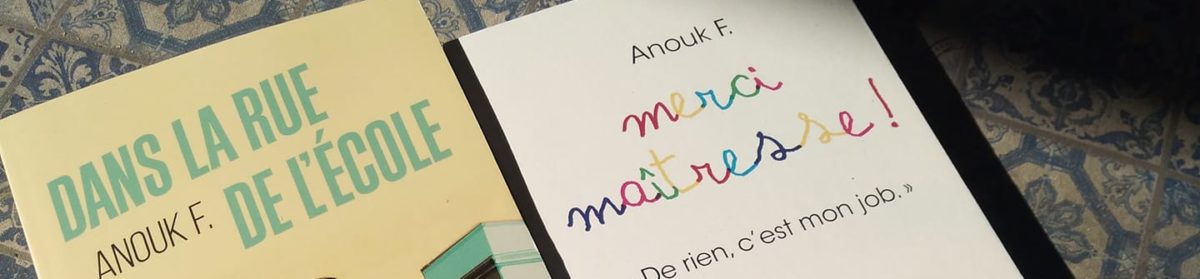Dis, toi, est-ce que tu te souviens ?
Est-ce que tu te rappelles de l’école, avant ?
Si, si, ferme les yeux et essaie un peu.
On voyait vos sourires, on voyait vos étreintes.
On acceptait vos bras qui se serraient contre nos genoux, parce qu’ils s’étaient moqués de toi, ou parce qu’elle ne voulait plus être ta copine, ou juste comme ça, parce que “t’es belle maîtresse”.
On vous regardait tirer la langue, la coincer entre vos dents quand le calcul était trop compliqué, ou la lettre trop difficile à enchaîner à la suivante.
On vous faisait un sourire, ou une grimace. On se servait déjà de nos yeux, mais ils accompagnaient le reste.
On vous emmenait nager, courir. On vous observait lutter, monter les uns sur les autres, pendant les séances d’acro-sport, tenir le tee-shirt du suivant puis le consoler, parce qu’il n’avait pas réussi, et lui promettre de l’aider, pour le tour suivant.
Dis, toi, est-ce qu’elle te manque, cette école – là ?
A moi, elle me manque, beaucoup.
Trop.
Cette école où on ne vit pas les uns à côté (mais pas trop) des autres, mais les uns avec les autres, et même les uns sur les autres, parfois.
Cette classe où on n’a peur de rien, même pas de s’asseoir tous collés sur le banc, de prendre discrètement la main de celui d’à côté, puis de l’enlever, les joues roses et le souvenir à jamais ancré.
Ce moment où tu as juste murmuré la bonne réponse mais que je l’ai entendue parce que je l’ai lue sur tes lèvres, alors je t’ai félicité.
Cette cour dans laquelle on n’a même pas peur d’aller jouer avec les plus grands de la classe d’à côté, ni avec les plus petits, parce qu’ils aiment bien que tu leur apprennes des choses.
Ces maîtresses qui se font la bise, se serrent parfois dans leur bras.
Ce lieu où on apprend, oui, mais ensemble, sans avoir peur, jamais, sans se dire que tu as peut-être en toi quelque chose qui va lui faire du mal, après, à elle, ou à quelqu’un avec lequel elle vit.
Cette école où on grandit sans angoisse, juste avec l’envie d’y être et d’y retourner encore.
Ce portail qui se ferme sur les inquiétudes qui n’ont pas le droit d’y entrer.
Alors dis-moi, tu t’en souviens, maintenant ?