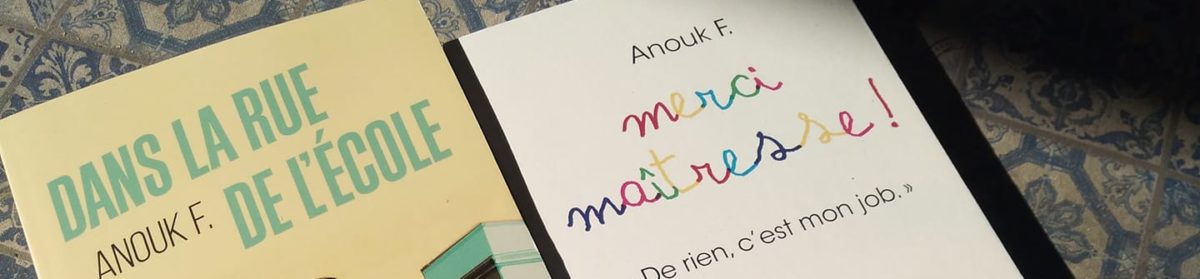A ma collègue qui me demandait de lui expliquer les difficultés de D., je me souviens lui avoir répondu d’imaginer un beau jardin. Pas très grand, mais fleuri, avec quelques petits arbres et peut-être même une petite, toute petite mare dans un coin. Je dis peut-être parce qu’en fait, je ne sais pas bien à quoi il ressemble vraiment ce jardin, et c’est bien le problème.
Le joli jardin de D., il est encombré. Les branches des petits arbres se montent les unes sur les autres, les fleurs poussent, oui, mais les herbes folles sont plus nombreuses, plus hautes et plus odorantes. La petite mare déborde souvent, quand elle n’est pas complètement à sec. Il n’y a pas de saison dans le jardin de D., les abeilles n’y trouvent pas leur chemin et même le plus téméraire des papillons ne saurait pas où se poser tant la confusion qui y règne est immense.
Et pourtant, ai-je continué à expliquer, moi je sais que dans le jardin de D., on pourrait cultiver de bonnes choses, voir pousser de belles fleurs et même nicher de jolis oiseaux.
En attendant, c’est le bordel là-dedans alors on essaie de repousser cette branche en se disant qu’on va enfin y voir plus clair, mais il ne lui faut pas plus de trois minutes pour retomber et revenir tout obscurcir.
« D., quelles sont les lettres de ce mot ?
-m, a, c, h, i, n, e
-Oui, c’est bien, on essaie de le lire ?
D. se tord tout à coup les doigts, de vilaines grimaces apparaissent sur son visage et beaucoup de peur dans ses yeux.
– Mmmmmma
– Oui, la première syllabe, c’est ma. Tu lis la deuxième ?
– chi…
– Très bien ! La dernière maintenant ?
– ne.
– Ok, super D. On les remet ensemble ?
Les doigts se tordent à nouveau, les grimaces sont revenues et voilà les jambes qui s’agitent à leur tour. D. me regarde, secoue plusieurs fois sa tête pour dire qu’il ne sait pas, qu’il ne veut pas et je vois ses yeux s’éloigner de moi, du mot, des lettres et de tout le reste. La branche nous est retombée dessus et le rayon de soleil a disparu.
D. sait des choses, beaucoup de choses. Quand nous “questionnons le monde’’, D. a souvent le bras levé et les bons mots sortent de sa bouche, même s’ils ne sont pas dans le bon ordre. D. s’emmêle les pinceaux comme il s’amuse à emmêler ses doigts. Parce que le mot qu’il faut est comme l’abeille, il ne trouve pas son chemin dans ce jardin. Les lettres se bousculent en même temps que les idées, les sons ne sortent pas toujours très droits et la bouche se presse tellement qu’il est parfois difficile de comprendre ce qui en sort. D. sourit quand même, pousse ses lunettes sur son nez, se rassoit et se remet à tripoter ses doigts, peut-être pour les empêcher d’asticoter le voisin.
D. ne marche absolument jamais. Il court, il sautille, fait des pas chassés. Du banc jusqu’au tableau, de la classe jusqu’aux toilettes, il gigote, s’agite, saute à pieds joints. Il y en a de vilaines racines à éviter sur ton chemin D., mais fais-toi confiance, un pied devant l’autre et ça ira.
Il s’est battu D., toute l’année. Il a poussé les branches, a même réussi à en couper quelques-unes. Il a fini par accepter ce crayon qu’on demandait à ses doigts de tenir sans trop bouger. Chaque boucle refermée était une mauvaise herbe arrachée, chaque lettre formée était un arbre qui grandissait, chaque ligne respectée une fleur qu’on voyait enfin pousser.
Je suis une piètre jardinière, comme lui. Alors on a demandé de l’aide. Avec D., on a passé une petite annonce ; “Recherchons outils bien aiguisés et mains vertes pour débroussailler”. Un épais dossier nous avons rempli, avec toutes sortes de bilans dedans : ergothérapeute, orthophoniste, orthoptiste et d’autres trucs en -iste. J’aurais bien ajouté un mot du paysagiste. Maman a signé, Papa a tiqué.
On s’est quittés comme ca, D. et moi. Je lui ai dit de continuer à débroussailler et puis j’ai croisé très fort les doigts moi aussi, quitte à les emmêler.
Et puis il y a eu ce SMS, en ce jour de fin juillet : “Bonjour Madame F., je suis la maman de D., je voulais vous informer que D. aura bien une aide personnalisée pour la rentrée avec une Auxiliaire de Vie Scolaire attribuée par la MDPH. Cela lui sera d’une grande aide, je voulais encore vous remercier.”
Mes doigts j’ai dénoués et ce fut à mon tour de grimacer. Il parait que je suis moche quand je me mets à pleurer.