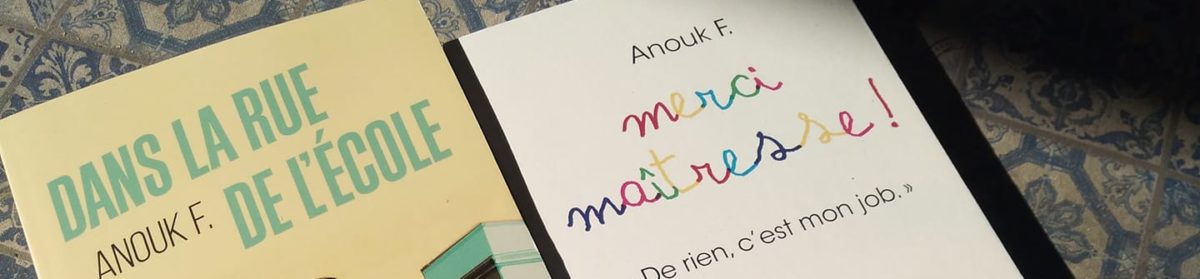Comme il est étrange ce lundi.
Comme il est froid, gris et un peu triste, aussi.
Je crois que mardi sera comme ça aussi.
Et j’ai bien l’impression que les jours suivants le seront à leur tour.
Pourtant, j’ai fait la maîtresse, comme les autres lundis. Et je le referai demain, comme les autres mardis. Je leur ai dit « asseyez-vous, on va commencer par la lecture ». J’ai ajouté « Oui, c’est bien, tu essaies de lire la consigne suivante tout seul ? ». J’avais devant moi des élèves attentifs, j’ai corrigé des fiches de travail sans erreur et je leur ai même dit « Vous pouvez aller jouer, on fera des mathématiques cet après-midi ».
Mais il en a manqué des choses. Il en a manqué, du bruit. Non pas que ces deux-là ne sachent pas à en faire, mais il a manqué de cette ambiance qui pourtant m’électrise parfois. Il a manqué de ces mouvements, de ces doigts levés, de ces « maitresses » répétés à tue-tête, de ces yeux qui ne comprennent pas ou de ceux qui justement ont compris et brillent de s’en rendre compte. Elles ont manqué toutes ces choses là et risquent de manquer encore.
Parce qu’elles ne peuvent arriver que là, que lorsqu’on est tous là, dans cette classe-là, entre ces murs-là. Parce que c’est aussi pour ça qu’on s’y retrouve. Pour ça même plus que pour le reste, des fois.
« Maîtresse, tu sais, moi je l’aime pas ce coronavirus, parce que tu vas me manquer ».
Comment s’est passée ta journée, A. ? Et toi, G., qu’as-tu fait en te levant ce matin ? Est-ce Maman t’a demandé de t’asseoir autour de la table pour commencer les nombreux exercices que nous avons préparés, si rapidement, pour vous, vendredi ? Avec elle G., es-tu restée assise ? As-tu accepté les consignes ? As-tu essayé G., juste essayé d’y arriver ?
Je me demande aussi comment ça s’est passé pour E., qui aime tant sautiller quand il entre dans la classe. Et pour M., si fier de ses progrès en Français, quelques mois après son arrivée dans notre pays. Et pour la maman de Y., qui était venue me trouver, la semaine dernière, pour me dire qu’à la maison, elle ne lui obéissait pas, qu’elle n’en pouvait plus, qu’il fallait que je l’aide. Et A., qui se débrouillait si bien avec sa ficelle colorée et qui était si fière d’expliquer aux autres comment s’y prendre.
La continuité pédagogique ne prévoit pas ça et je ne sais pas si quelque chose peut remplacer ces choses-là.
Les semaines prochaines seront longues, peut-être de moins en moins grises, peut-être un peu moins tristes. On chantera peut-être des chansons à nos balcons, on se servira peut-être du café par la fenêtre, on s’écrira des mots qu’on s’enverra dans des avions en papier.
On remplacera les lundi gris par des lundi arc-en-ciel. Et puis c’est promis, on s’y retrouvera. Là-bas, dans cette classe-là, entre ces murs-là. On essaiera de rattraper tout ce temps-là.
On y arrivera.