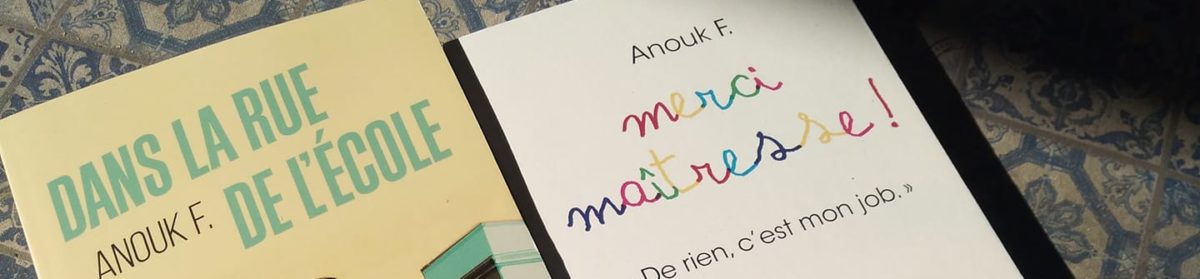Dans ma REPpublique à moi, il y a des arrivées inattendues. Des bruits venus de si loin qui sont tout à coup tout près, là, chez nous. Alors on accueille, on écoute, on accompagne, comme on peut.
Je ne sais pas combien de temps ni combien de fois j’ai regardé ces quatre lettres sur la fiche de renseignements. Il n’était pas encore arrivé. Demain, m’a dit la directrice. En attendant, je me suis posée un demi-million de questions, le trajet qu’il avait fait, ce qu’il avait vécu, depuis les quatre lettres inscrites là, dans la case « ville de naissance ».
Homs, Syrie. Année de naissance : 2006.
« Ecole, moi ? Non, un, juste un » Une année d’école donc.
« Après, école, boum.. Walou ». Plus rien.
A. connaît quelques mots de français. A. en connaîtra bientôt beaucoup, beaucoup d’autres, parce qu’il a envie d’apprendre. Non, il n’a pas juste envie, il est impatient d’apprendre, il trépigne. Il râle même, quand j’envoie d’autres élèves de la classe au tableau poser des opérations.
« Maîtresse, moi !
– Pas maintenant A., il faut que tu apprennes encore un peu, que je te montre comment on pose des additions, les retenues, tout ça. Bientôt.
– Bientôt, oui, bientôt ».
Ses yeux pétillent, en redemandent. Je me sens un peu impuissante, pour l’instant. J’ai peu de temps pour lui, tout seul. Il passe beaucoup de temps avec O., la maîtresse qui s’occupe des enfants allophones mais il en passe aussi avec moi. Pour faire partie de la classe, du groupe, pour entendre le français, baigner dans la langue, dans nos habitudes de classes, dans notre petite vie. Pour faire connaissance.
Il a envie de parler A., mais il n’y arrive pas forcément avec des mots, alors il fait des gestes. En souriant, tout le temps, malicieusement. Quand on est arrivés au parc, dans l’après-midi, un avion est passé au-dessus de nos têtes. Les autres enfants ont levé la tête et l’ont montré, amusés. Lui aussi l’a regardé, puis il m’a tiré le bras. Il a parlé vite, je n’ai pas compris. Alors il a mimé. Avec des gestes, avec du bruit. L’avion, le bruit des bombes, de grands gestes des bras pour me raconter les ruines, les blessés. Il a continué, se disant que cette fois, je comprenais peut-être, avec des mots, et des gestes, encore. Le bruit des bombes, des rafales et, plusieurs fois « Souria », ou encore « Bachar », les sourcils froncés.
Sur le chemin du retour, A. s’est assis dans le bus près de R.. R. parle un peu arabe, pas tout à fait le même que lui, mais ils arrivent à se comprendre. Je suis assise juste à côté d’eux. Ils rigolent. A. montre à R. comment faire le bruit du pet en mettant sa main sous son aisselle. R. est plié de rire. Je cesse quelques minutes de les observer et quand mon attention revient vers eux, A. fait les mêmes gestes que ceux qu’il a fait devant moi tout à l’heure, au parc. Les mêmes gestes et les mêmes bruits. Les bombes, les rafales. « Walou ». R. écoute, à la fois impressionné et effrayé.
Je leur ai déjà parlé de la Syrie, de la guerre, des morts, des blessés, des migrants, de Bachar. Ils avaient posé beaucoup de questions, ce jour-là, je m’en souviens, mais sans doute, comme nous, avaient-ils pensé que c’était loin, très loin d’eux. Aujourd’hui, c’est là, tout près, c’est A. Ils ont pourtant été très pudiques, très respectueux quand je leur ai dit d’où venait A., n’ont pas posé de question. Mais ce soir, j’ai l’impression que A., lui a envie, a besoin d’en parler.
L. est une AVS de l’école. Elle s’occupe d’un enfant d’une autre classe. Elle parle arabe alors je lui demande de venir dans ma classe et de parler avec A., de lui demander s’il souhaiterait discuter avec le reste de la classe, s’il accepterait que ses camarades lui posent des questions sur la Syrie, sur ce qu’il a vécu. A. sourit, applaudit, il est d’accord, il en a envie, très envie. L. reste quelques minutes pour traduire les questions, puis les réponses de A.
« Est-ce que tu es déjà allé à l’école ?
– Oui. Un an, puis mon école a été détruite. Plus personne n’allait à l’école.
– Est-ce que tu connais le Président de la Syrie, et qu’est-ce que tu en penses ?
– Bachar, oui, je ne l’aime pas, non. C’est à cause de lui que je suis parti de Syrie, je ne voulais pas partir, c’est mon pays, je l’aime mon pays. »
Silence. Je demande à L. de s’assurer qu’il a encore envie de parler, s’il veut qu’on arrête, qu’on parle d’autre chose. Il sourit, veut continuer.
« Est-ce que des membres de ta famille sont morts ? »
On se regarde quelques secondes avec L., A. trépigne, veut savoir ce qu’on lui a demandé, tout de suite. Je fais signe à L. de traduire.
La réponse de A. est longue. Il parle vite, fait beaucoup de gestes. A un moment, il passe sa main sous sa gorge, avec un geste bref. Puis un autre avec le bras qui descend du ciel et tombe sur sa jambe. L. me regarde, désemparée.
«Tu n’es pas obligée de tout traduire. Ne traduis que ce qu’ils peuvent entendre, je te fais confiance.
– D’accord. Il vaut mieux. Alors la réponse est oui, il a perdu des membres de sa famille. Le cousin de sa mère et son grand-père.»
Cette fois, A. veut arrêter. Beaucoup d’enfants ont le bras levé, pour lui poser des questions. Je leur explique que ce qu’a vécu A. est difficile ; qu’il faut lui laisser un peu de temps, qu’il n’a plus envie de parler, là maintenant.
Je demande à L. de lui traduire quelques mots, de la part de toute la classe.
« A., merci de nous avoir parlé. Nous, on voulait te dire qu’on était tous très heureux que tu sois là aujourd’hui, qu’on était très fier de t’accueillir ici et qu’on allait tous t’aider à apprendre notre langue au plus vite.
– (en Français) Merci maîtresse, merci. »
Puis il s’approche de L., lui dit quelque chose à l’oreille. L. éclate de rire et se retourne vers moi.
« Il demande s’il peut avoir des cahiers, comme ceux des autres, avec toutes les opérations ».
WordPress:
J'aime chargement…