
“Vous pouvez sortir vos petites étiquettes.
Huit paires d’yeux scannent les tables qu’on leur a installées.
D’un côté, un pot à stylo et une petite barquette, avec des ciseaux, de la colle, une gomme.
Sur chaque objet, un autocollant nominatif.
Et à gauche, un tas de feuilles, imprimées la veille.
Personne ne peut plus les toucher, à part celui qui est assis là.
“Non, pas les gommettes G., les étiquettes !
Non pas là, juste à côté. , enfin de l’autre côté. Euh au-dessous, l’autre encore..
Je ne peux pas m’approcher à moins d’un mètre, alors je tends mon index (mais pas trop) et j’essaie de la guider. Elle panique. Le tas de feuilles tombe à terre. Je sens qu’elle va pleurer. Non, je ne ramasserai pas les feuilles, je n’ai pas le droit d’y toucher. Mon regard scanne à son tour la pièce. En un instant, ma main pousse le pressoir du gel hydro-alcoolique, j’en fais couler partout sur mon bureau mais tant pis, urgence. Je frotte mes paumes, mes doigts, mes pouces et je vole ramasser les feuilles de N., qui n’a pas eu le temps de pleurer et qui n’avait visiblement de toutes façons pas l’intention de se baisser.
“Voilaaaa ! C’est ça, les étiquettes !
“Moi aussi, maîtresse, montre moi, c’est quoi les étiquettes ?!!”
“Maîtresse, j’ai envie de me moucher.
– Oui, I. Il y a une boite de mouchoirs rien que pour toi dans ton casier. Voilà, oui, c’est ça.
– J’arrive pas à l’ouvrir.
– Alors il y a une languette dessous. Non, retourne la boite. Ne la secoue pas, la languette ne va pas apparaître toute seule, tourne-la. Oui, là, tu l’as tournée mais pas comme ça. Horizontalement. Ah ? Tu sais pas ce que ça veut dire horizontalement ? Alors ça veut dire que la boite elle reste couchée et tu la retournes du bas vers le haut. Ou du haut vers le bas, c’est comme tu veux. Comment ça tu comprends rien à ce que je dis ? Regarde le geste que je fais, il faut que tu fasses pareil. Non, avec la boite dans les mains… Attends I., je vais le faire”.
Nouveau braquage des yeux vers le bureau.
Stupeur : le gel-hydroalcoolique a disparu. J’ai dû le laisser à côté de la machine à café tout à l’heure. Retour vers I., ce ne sont pas des larmes qui s’apprêtent à couler mais bien de la morve liquide qui goutte déjà au bout de son nez. Même pas le temps d’aller me laver les mains. L’infirmière a bien dit trente secondes de lavage minimum, et la goutte là, je ne lui en donne pas 10 pour faire une flaque sur les fameuses étiquettes. Et comme je ne pourrai pas lui en imprimer d’autres parce qu’il n’y a plus de toner dans la photocopieuse… Prête à baisser les bras, je me retourne vers l’enfant à la goutte au nez (tiens ça ferait un joli nom de tableau ça ?). Armé de son ciseau nominatif, l’ingénieux est en train littéralement de poignarder la boite à mouchoirs. J’ai presque envie d’aller l’aider tellement ça a l’air jouissif. Il arrache un tissu déjà bien amoché de la boite, le porte à son nez si vite et si violemment qu’il renverse la bouteille d’eau dont le bouchon n’était pas fermé sur les étiquettes que je ne pourrai pas lui réimprimer. Mais l’éponge, elle est désinfectée ?
#maviedeprofdéconfinée
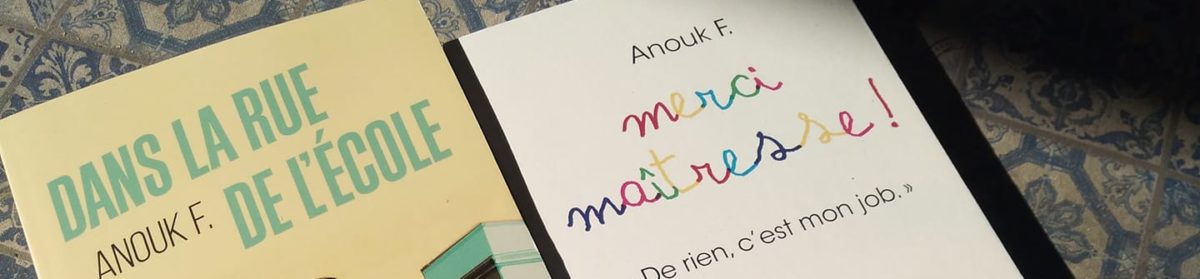

 (Photo : Christian Capron)
(Photo : Christian Capron)





