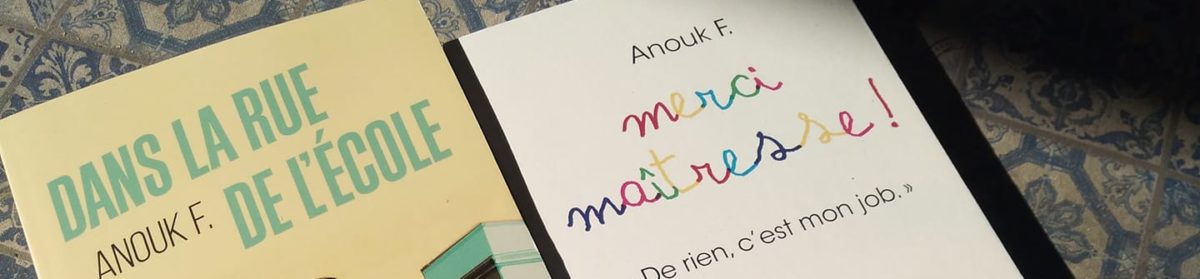En règle générale, c’est dans le bus que les choses sérieuses commencent réellement. Au bout de dix, parfois seulement cinq minutes, quand le teint de M. tourne au très pâle, que les yeux de R. se mettent à tourner dans le mauvais sens et que tu as juste le temps de te dédoubler pour leur apporter à chacun un sac en plastique que, cette fois, tu avais pensé à emmener. Le premier vomi sorti, tu peux tranquillement déclarer la sortie de fin d’année officiellement entamée. C’est comme couper un ruban rouge, mais avec des grumeaux et l’odeur en plus.
Alors ensuite tu les comptes quand ils descendent du bus, juste pour être sûre qu’il n’y en a pas un qui s’est endormi dans le vomi du copain. Tu leur visses les casquettes sur la tête, vas récupérer le sac de pique nique que L. a oublié à l’intérieur, demande à M. pourquoi elle est venue en sandales alors que tu lui avais bien expliqué qu’aujourd’hui, on allait marcher et te voilà quasiment prête à leur demander de te suivre, où tu iras ils iront, pas fidèles et carrément pas à l’ombre.
Le problème, c’est quand la randonnée que tu as prévue commence par une bonne centaine de mètres sur la route, forcément avec des virages, forcément carrément dangereux. Tu flippes parce que ni R., ni T. et encore moins O. ne comprennent précisément le concept de « rester en file indienne sur le côté ». Du coup, tu prends les choses en main, les bras tendus au max du max, tu marches à pas chassés, faudra te passer sur le corps d’abord pour espérer les renverser.
Ta collègue qui mène le cortège marche évidemment beaucoup trop vite. Toi, tu t’es postée au fond, avec les escargots, les turbulents qu’on t’a envoyés en cours de balade, les pas contents et M., ses sandales et les cailloux qui se coincent à l’intérieur. P. te demande toutes les 45 secondes à peu près si on peut s’arrêter pour boire. A. te fait bien comprendre, en soufflant avec beaucoup de bruit, que franchement, il est épuisé et que s’il avait su, il serait pas venu. Tu regrettes bien fortement toi aussi qu’il n’ait pas su.
La randonnée avance et de mauvaises pensées t’envahissent insidieusement. En oublier un, assurer à cet autre qu’il faut tourner là et partir en courant, rajouter quelques pierres dans le sac à dos de celui-là, ça lui passera peut-être l’envie de chanter du Soprano en boucle depuis une heure, dessiner une fleur sur le bras de celle-ci avec la crème solaire, sa mère trouvera sûrement ça très classe.
Alors tu regardes ta montre et tu respires tout à coup beaucoup mieux. Selon le petit dépliant de la randonnée, on devrait arriver dans dix minutes. C’est passé vite finalement. La collègue de devant s’arrête alors et hurle « Pause, on est à mi-chemin » et tu sens tes jambes défaillir, si tu simules un malaise, tu finiras peut-être le trajet sur les épaules du joli remplaçant, là juste devant.
Le dos plein de sueur, les mains grises de la terre qu’ils ont grattée à chacune de leur chute, le visage meurtri par tant de souffrance imposée à de si petits êtres en une matinée, les voilà arrivés et prêts à pique-niquer. Après le ruban rouge, on est là dans le vif de la sortie de fin d’année. Grosse déception cette année, avec seulement un hamburger froid de chez Mac Do et son paquet de frites tout aussi froides, mais quand même un peu réchauffées quand elles se sont une à une renversées dans le sac à dos pendant la randonnée. Il a quand même fallu suggérer à A. de commencer par le sandwich avant de manger la pomme, mais là-dessus, ne soyons pas fermés d’esprit. Pour sûr, aucun d’entre eux n’avait encore une seule goutte d’eau dans sa bouteille, la cohue autour du robinet a donc eu lieu. Pas de blessé, quand je vous dis qu’on est sur un cru assez exceptionnel.
Ensuite, le village il a fallu visiter. Avancer, s’arrêter, écouter la guide expliquer comment cette magnifique voûte a été construite, pourquoi cette pierre a une couleur différente des autres. Trouver ça quand même super intéressant et tout à coup regarder le groupe d’enfants et constater que trois sont allongés au milieu de la ruelle, deux affalés contre la porte du restaurant, trois autres jouent à trappe trappe sur la place derrière toi et le reste de la bande, en grande partie non francophone, regardent avec les yeux écarquillés la dame, pourtant très enthousiaste, comme s’ils la suppliaient d’arrêter.
Il est 16h et quand tu vois le bus du retour entrer sur le parking, tes yeux à toi pétillent à nouveau. C’est fini, tu vas rentrer. Dans moins de deux heures, sous ta douche, tout ceci sera oublié. Alors une fois que tu les as comptés, regrettant presque de ne pas en avoir oublié – j’ai dit presque – tu les brieffes en leur demandant de profiter du retour pour se reposer et tu leur proposes même un grand jeu : et si on chuchotait ? Le jeu le plus pourri du monde, te répondent-ils avec leurs têtes pourtant fatiguées et le volume augmente, augmente, jusqu’à ce que le bus, en plein milieu de la route s’arrête. Silence complet. Le chauffeur se tourne vers toi et tes collègues, lève les deux mains sur les côtés. Désolé. En panne. Il va falloir qu’un autre bus vienne vous chercher.
Il est 18h, ta douche a été l’une des meilleures de ta vie. Tu te poses sur ton canapé, demande à tes enfants de s’approcher. Sur ton téléphone, tu leur montres les photos que tu as prises aujourd’hui, la randonnée, le pique-nique, les chansons qu’on a chantées. Ton plus jeune fils te dit « Maman, vous avez l’air de vous être vraiment régalés ! ».
Tu le regardes et tu sais que ce qu’il dit est vrai.