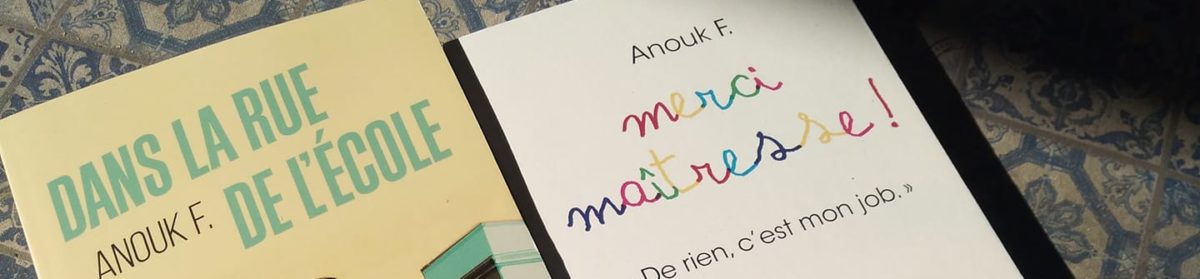Je suis venue la trouver pour savoir comment il allait. Comment il se comportait quand il n’était pas avec moi, dans notre petit groupe où nous jouons, mimons, bougeons. Comment il s’en sortait quand il baignait des heures d’affilée dans cette langue qu’il ne maîtrise pas encore, même s’il redouble d’efforts pour l’entendre, l’apprivoiser et la faire sienne.
Elle m’a regardée fixement, a posé ses mains sur ses hanches et m’a répondu : « Rien, il ne fait rien », en insistant sur le R, comme s’il pouvait représenter à lui seul toute la colère qu’elle voulait exprimer et un peu du mépris qu’elle semblait lui réserver.
Les mots qui voulaient sortir de ma bouche n’étaient pas les bons, alors je les ai ravalés. Je n’ai pas souri, j’ai juste soutenu ce regard et essayé d’y lire la bienveillance que j’aurais aimé y trouver. Le lendemain, quand je l’ai ramené dans cette classe où les autres le regardent avec tant d’étrangeté, j’ai senti mon ventre se nouer et aurais tout donné pour ne pas l’y abandonner.
Alors je les ai tous regardés. Celui-là donc, qui ne parle pas le français. Cet autre-là, pour lequel associer des consonnes et des voyelles est si couteux, même du haut de son mètre soixante. Celui-ci, qui ne parvient pas à comprendre comment autant de zéros peuvent vouloir signifier une quantité. Et puis ce bonhomme, juste à gauche, dont le cerveau va si vite qu’il préfère balancer sa chaise que d’enchaîner les si nombreux exercices qu’on a jugé bon de lui imposer.
Je les ai tous observés et je me suis autorisée à rêver : et si on leur donnait une chance, à tous, un par un ? Si on cessait de penser qu’ils sont les mêmes? Si on lâchait un peu nos manuels si colorés, nos programmes si engoncés, nos exigences si uniformisées ? Si on arrêtait d’y voir un troupeau mais qu’on les regardait pour ce qu’ils sont : des individus, uniques, spéciaux, particuliers.
Avec ce point commun, le seul, celui qui doit nous guider : le droit d’apprendre, quoi qu’il nous en coûte.